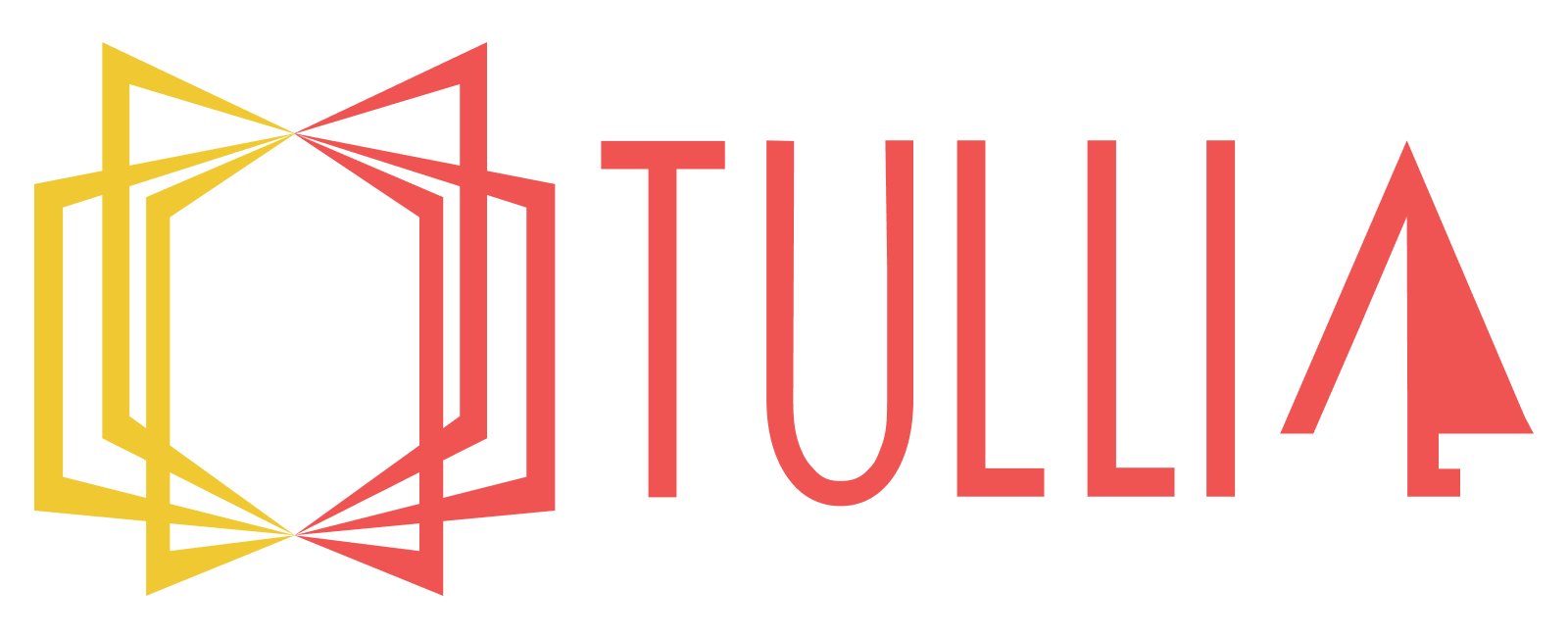La prostitution n’est pas illégale en France
La prostitution en tant que telle est une activité libre. Son exercice est cependant restreint par des prohibitions spécifiques : définition très large du proxénétisme, pénalisation des clients, arrêtés municipaux et préfectoraux

Définition de la prostitution
La prostitution n’est pas définie dans le code pénal. La définition est jurisprudentielle, c’est-à-dire qu’elle est issue de décisions de justice antérieures.
La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui
Crim., 27 mars 1996, pourvoi n° 95-82.016, Bull. crim. 1996 n° 138
Les activités de TDS virtuel / camming ne relèvent pas de la prostitution.
Cour de cassation – Pourvoi n° 21-82.283 (18 mai 2022)
Pénalisation des clients
Article 611-1 du code pénal
Solliciter, accepter ou obtenir des relations sexuelles d’un prostitué en contrepartie d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage
Le fait de recourir aux services d’une personne qui se prostitue est une contravention qui est punie d’une amende de 1500 €.
En cas de récidive, le recours aux services d’un prostitué n’est plus considéré une contravention, mais comme un délit. Ce délit est puni d’une amende de 3750 €.
Peines complémentaires :
- Stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat de prestations sexuelles
- Interdiction temporaire ou définitive de jouissance des droits civiques, civils et de famille
- Inscription au FJAISV – fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (depuis le 20 avril 2021)
Un Français ou un étranger qui vit en France peut être poursuivi par la justice française pour des faits commis à l’étranger si la personne qui se prostitue est une personne vulnérable.
La mesure de pénalisation des clients a été attaquée par des associations et des travailleur·ses du sexe au Conseil Constitutionnel et à la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Proxénétisme
Le proxénétisme recouvre une grande variété d’activités et de situations entourant la prostitution.
La violence ou l’exploitation ne font pas partie de sa définition légale : il ne s’agit que de facteurs aggravants.
Profit
Tirer profit de la prostitution d’autrui ou embaucher une personne en vue de la prostitution
Assistance
Aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui
Hôtelier
Accepter, tolérer, diriger […] la prostitution dans des locaux que l’on détient ou que l’on gère
Entremise
Faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se prostitue et l’autre l’exploite ou la rémunère
Légifrance : Code Pénal – Articles sur le proxénétisme
Jurisprudence récente atténuant l’infraction de proxénétisme d’assistance dans le cadre d’une entraide entre prostitué·es ayant pour objet de préserver le respect de la dignité de la personne.
Pourvoi n° 23-80.437 de la Cour de cassation – 9 août 2023
Proxénétisme : la loi protège-t-elle vraiment les personnes qui se prostituent ? – The Conversation 19/05/2025
Mathilde Geoffroy, Hélène Le Bail, Marie Mercat-Bruns. L’incrimination large du proxénétisme en France pose-t-elle problème ? Comment les professionnel•les du droit composent avec les paradoxes des infractions de proxénétisme pour les mettre en œuvre. 2025. ⟨hal-04889124⟩
Racolage
Le délit de racolage (actif ou passif) a été abrogé en 2016.
ARCHIVES INA – La répression de la prostitution : la loi sur le racolage passif 06/05/2003
Mineur·es
Le recours à la prostitution des mineur·es est interdit (article 225-12-1 du Code pénal) et l’infraction de proxénétisme est alors aggravée (article 225-7 du Code pénal).
Toute personne ayant connaissance d’un cas de prostitution infantile a obligation de le signaler aux autorités (articles 434-1 et 434-3 du Code pénal). Les associations sont également soumis à cette obligation.
Le 119 – Enfance en danger permet un signalement par téléphone 24h7j. Pour ce qui est des contenus Internet, il est possible de passer par Pharos.
Arrêtés municipaux et préfectoraux anti-prostitution
Section en cours de rédaction – merci de votre compréhension !
Bien que les travailleur·ses du sexe soient considéré·es en France comme des « victimes » vu la position néo-abolitionniste, l’un des moyens de repénaliser la prostitution consiste à voter des arrêtés municipaux qui interdisent l’exercice de la prostitution sur un territoire, le plus souvent des rues d’un quartier ou une route départementale.
Ces arrêtés doivent obéir à certaines règles, rappelées par cette circulaire de 2002 :
- Troubles avérés à la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques : nuisances sonores, sécurité routière, préservatifs abandonnés, etc.
- Atteinte à la moralité publique : exhibition, tenues provocantes ou fortes concentration de TDS à proximité d’établissements d’enseignement, d’un lieu de culte, d’un monument aux morts, de parcs fréquentés par les familles, de nombreuses résidences, etc.
- Mesures nécessaires et proportionnées aux risques : justifiées par la pratique et clairement limitées dans le temps et l’espace.
Plusieurs arrêtés s’avèrent illégaux et sont invalidés devant les tribunaux (comme celui de Chassieu). Le Strass a d’ailleurs pour politique de les attaquer systématiquement. Les procédures sont cependant longues, à tel point que même lorsqu’ils sont immédiatement contestés, ils sont souvent déjà échus au moment où ils sont déclarés invalides par un juge. De plus, il est difficile d’effectuer un travail de veille à l’échelle des municipalités, alors même que les délais sont courts pour pouvoir contester.
Les arrêtés anti-prostitution ont précédé le délit de racolage actif et passif (réinstauré par la LSI de 2003). C’est Gérard Collomb, ancien maire de Lyon (2001-2020), qui a lancé la tendance dès 2002.
Les arrêtés ont pour conséquence d’augmenter la répression et, ironiquement, les tensions avec les riverains. Perçu·es comme des nuisances, les TDS sont repoussées dans les marges de la ville, sur des départementales moins bien éclairées, plus isolées. Cela complique le travail des associations de prévention et toutes les relations avec les forces de l’ordre.
Paris
(à compléter)
Lyon
La meilleure couverture médiatique du sujet se trouve sur Rue89. C’est le fruit du travail des journalistes Laurent Burlet, puis Pierre Lemerle qui ont pris le temps de se former sur le sujet et de s’adresser aux personnes visées par les arrêtés et les associations.
- Webdoc – Les filles de Gerland – 2013
- Chronologie : à Lyon, 12 années d’arrêtés municipaux anti-prostituées – octobre 2014
- Pénalisation des clients de prostituées : Lyon n’applique pas la loi mais les arrêtés municipaux – avril 2018
- Karen, la porte-parole des prostituées de Gerland à Lyon, est morte – mars 2021
- Dans l’Est lyonnais, le calvaire des prostituées – avril 2021
- Prostitution à Lyon : vers la fin des arrêtés municipaux anti-camionnettes ? – décembre 2020
- A Lyon, un premier pas vers la fin des arrêtés municipaux anti-prostituées – mai 2022
- Prostitution à Lyon : 20 ans de politique municipale, du centre-ville à Gerland – décembre 2022 (abonnés seulement)
Plus récemment, c’est la préfecture du Rhône qui a pris un arrêté pour nettoyer la Plaine des jeux de Gerland, en prévision de la coupe du monde de Rugby. Les TDS en camionnettes avaient été repoussées vers ce secteur suite aux arrêtés mais aussi à la pose de plots les empêchant de circuler, placés pendant le 1er confinement. Leur présence à proximité des infrastructures sportives gênaient tout le monde, à commencer par les TDS qui ont pour la plupart des enfants et n’avaient aucune envie d’en être si près. Un collectif de parents mettait alors la pression sur la mairie, devenue EELV (qui ont une position théoriquement anti-prohibition quant au TDS) aux dernières élections municipales.
France 3 régions – Prostitution à Lyon : un arrêté préfectoral interdit les camionnettes dans le quartier de Gerland
Toulouse
(à venir)
Parcours de sortie de la prostitution
Jurisprudence : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 novembre 2021 (n°440802) : « […] pour juger que le préfet était fondé à refuser à Mme C… l’autorisation d’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qu’elle sollicitait, les circonstances qu’elle n’avait pas encore arrêté de se prostituer et qu’elle n’avait pas déposé de plainte à raison d’infractions portant sur la traite des êtres humains ou le proxénétisme, le tribunal administratif de Lyon s’est fondé sur des éléments qui ne pouvaient, contrairement à ce qu’il a jugé, caractériser l’absence de réalité de l’engagement de la personne et a, par suite, commis une erreur de droit. » En résumé, on ne peut exiger que la personne ait arrêté la prostitution ou déposé plainte pour proxénétisme ou traite des êtres humains comme condition préalable à son parcours de sortie.
ACCES AU PARCOURS DE SORTIE DE PROSTITUTION (PSP) : une enquête nationale au cœur des réalités de terrain. Fédération des acteurs de la solidarité, avril 2025.
Évaluations de la loi de 2016
Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, couramment appelée « loi de 2016 » ou « loi de pénalisation des clients »
- Amendes pour recours à la prostitution
- Parcours de sortie de la prostitution
- Fin du délit de racolage
Synthèse comparative des rapports d’évaluation de la loi – française sur la prostitution de 2016 – Néo Gaudy, Hélène Le Bail
Évaluation de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées – IGAS, IGA et IGJ – 2019
Réponses à l’évaluation de la loi de 2016 – associations communautaires et de santé – 2020 – Synthèse du rapport
Loi prostitution : ce qu’en pensent les travailleurs et travailleuses du sexe – Hélène Lebail et Calogero Giametta – 2018 – Synthèse du rapport
3 ans après la loi prostitution : quels constats des associations de terrain ?
Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme – Avis sur la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel
Rapports commandités par des associations abolitionnistes ⚠️
La situation de la prostitution en France – FACT-S
Rapport d’évaluation locale de la mise en œuvre de la loi 2016-444 de Jean-Philippe Guillemet et Hélène Pohu, Fondation Scelles et DGCS – 1er Narbonne Bordeaux Strassbourg et Paris – 2e Limoges, Marseille, Nantes, Toulouse
Jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH)
Pénalisation des clients
L’affaire concerne l’incrimination en droit pénal français de l’achat de relations de nature sexuelle qui placerait dans un état de grave péril l’intégrité physique et psychique et la santé des personnes qui pratiquent l’activité de prostitution et porterait radicalement atteinte au droit au respect de leur vie privée en ce qu’il comprend le droit à l’autonomie personnelle et à la liberté sexuelle.
La Cour relève que les problématiques liées à la prostitution soulèvent des questions morales et éthiques très sensibles, qui donnent lieu à des opinions divergentes, et qu’il n’existe toujours pas de communauté de vues, ni entre les États membres du Conseil de l’Europe ni au sein même des différentes organisations internationales saisies de la question quant à la meilleure manière d’appréhender la prostitution.
Elle observe ensuite que le recours à la pénalisation générale et absolue de l’achat d’actes sexuels en tant qu’instrument de lutte contre la traite des êtres humains fait actuellement l’objet de vifs débats suscitant de profondes divergences aussi bien au niveau européen qu’au niveau international, sans qu’une tendance claire ne s’en dégage.
La Cour conclut que les autorités françaises n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation en adoptant l’incrimination litigieuse dans la mesure où celle-ci résulte d’un arbitrage effectué selon les modalités démocratiques au sein de la société en cause et s’inscrit dans le cadre d’un dispositif global prévu par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 tenant compte des différentes préoccupations soulevées par les requérants dans la présente affaire.
Cela étant, la Cour rappelle qu’il revient aux autorités nationales de garder sous un examen constant l’approche qu’elles ont adoptée – en particulier quand celle-ci est basée sur une interdiction générale et absolue de l’achat d’actes sexuels – de manière à pouvoir la nuancer en fonction de l’évolution des sociétés européennes et des normes internationales dans ce domaine ainsi que des conséquences produites par l’application de cette législation.
La Cour conclut à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme.
Indemnisation des victimes de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle
L’affaire concerne les démarches engagées par Mme Krachunova pour obtenir une indemnisation correspondant aux revenus de son travail sexuel lui ayant été soustraits par X, son proxénète. Les juridictions bulgares ont refusé de lui accorder une telle indemnisation au motif qu’elle s’était livrée à la prostitution et que lui restituer les gains issus de cette activité aurait été contraire aux « bonnes mœurs ».
La Cour juge en particulier que les États ont l’obligation de permettre aux victimes de traite d’êtres humains de demander à la personne les ayant exploitées une indemnisation de la perte de revenus, et que les autorités bulgares ont manqué à leur obligation de mettre en balance le droit de Mme Krachunova, découlant de l’article 4, de former une telle demande, avec les intérêts de la collectivité, dont il est improbable qu’elle estime immoral le versement d’une indemnisation dans un tel cas de figure.
La Cour européenne reconnaît pour la première fois qu’une victime de traite a, au titre de l’article 4, le droit de demander réparation de son dommage matériel de la part de la personne l’ayant exploitée.
Protection de la vie privée
La Cour considère que le prélèvement sanguin imposé à deux requérantes s’analyse en une ingérence dans leur vie privée et relève que celui-ci n’était pas prévue par la loi au sens de l’article 8 de la Convention, dès lors que les dispositions de droit interne en cause se devaient d’être prévisibles quant à leurs effets pour les requérantes.
La Cour estime que la publication des données de quatre requérantes a constitué une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de la vie privée. En effet, les noms et photos des requérantes ainsi que l’information selon laquelle elles étaient séropositives ont été téléchargés sur le site internet de la police et diffusés par les médias et le procureur n’a pas recherché si d’autres mesures, propres à assurer une moindre exposition des requérantes, pouvaient être prises en l’espèce.